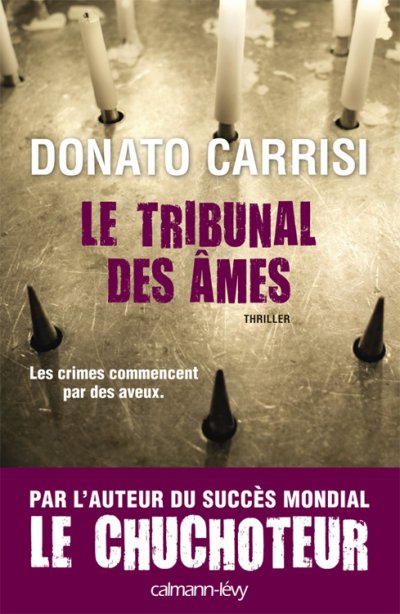
| Date france : |
2012.03.1 |
| Editeur : | |
| ISBN : |
9782702142967 |
Le Tribunal des âmes
2012
8 h
D'après votre vitesse de lecture (15 000 mots à l'heure), il devrait vous falloir environ 8 h pour lire ce livre.
Temps restant en fonction de l'avancement :
| 13 % | 25 % | 38 % | 50 % | 63 % | 75 % | 88 % |
| 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 3 h | 2 h | 1 h |
Les crimes commencent par des aveux.
Rome. Sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes de touristes. Sa pluie battante, ses sombres ruelles, ses labyrinthes souterrains et ses meurtriers insaisissables.
Marcus est un homme sans passé. Sa spécialité : analyser les scènes de crime pour déceler le mal partout où il se terre. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd’hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition d’une jeune étudiante kidnappée Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle aussi recueille les indices sur les lieux où la vie a dérapé. Il y a un an, son mari est tombé du haut d’un immeuble désaffecté. Elle n’a jamais tout à fait cru à un accident.
Leurs routes se croisent dans une église, devant un tableau du Caravage. Elles les mèneront à choisir entre la vengeance et le pardon, dans une ville qui bruisse encore de mille ans de crimes chuchotés au coeur du Vatican. À la frontière de la lumière et des ténèbres.
Rome. Sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes de touristes. Sa pluie battante, ses sombres ruelles, ses labyrinthes souterrains et ses meurtriers insaisissables.
Marcus est un homme sans passé. Sa spécialité : analyser les scènes de crime pour déceler le mal partout où il se terre. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd’hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition d’une jeune étudiante kidnappée Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle aussi recueille les indices sur les lieux où la vie a dérapé. Il y a un an, son mari est tombé du haut d’un immeuble désaffecté. Elle n’a jamais tout à fait cru à un accident.
Leurs routes se croisent dans une église, devant un tableau du Caravage. Elles les mèneront à choisir entre la vengeance et le pardon, dans une ville qui bruisse encore de mille ans de crimes chuchotés au coeur du Vatican. À la frontière de la lumière et des ténèbres.
Si vous avez aimé ce livre, ceux-ci peuvent vous plaire : Ces livres vous sont proposés car les lecteurs de NousLisons.fr qui ont aimé Le Tribunal des âmes les ont également appréciés.
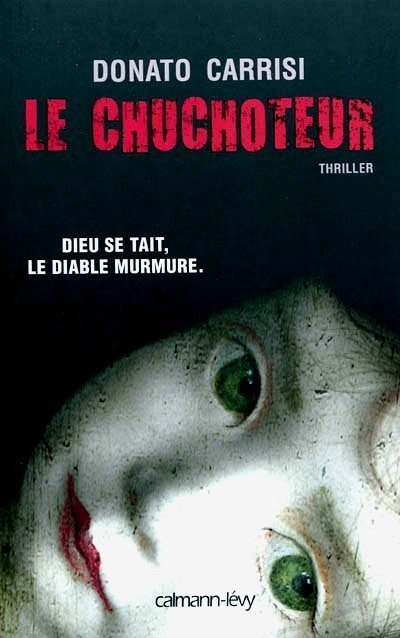
Le chuchoteur
de
Donato Carrisi
Mila Vasquez (1)
Thriller
Lecture en 10 h environ, Note : 4.4/5

L'Ecorchée
de
Donato Carrisi
Mila Vasquez (2)
Thriller
Lecture en 7 h environ, Note : 4.0/5
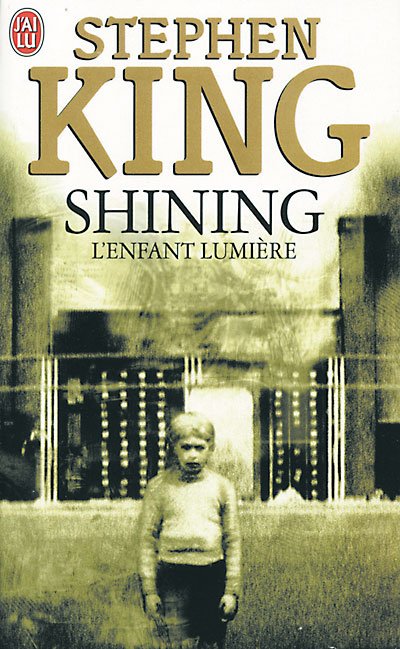
Shining
de
Stephen King
Shining (1)
Terreur
16
Lecture en 9½ h environ, Note : 4.3/5
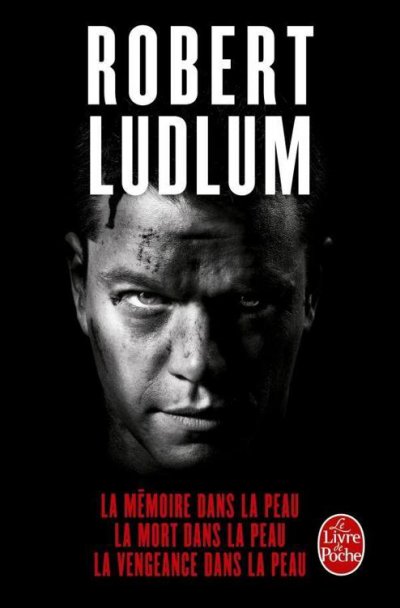
Trilogie Jason Bourne
de
Robert Ludlum
Jason Bourne (HS)
Thriller
Lecture en 46 h environ, Note : 5.0/5
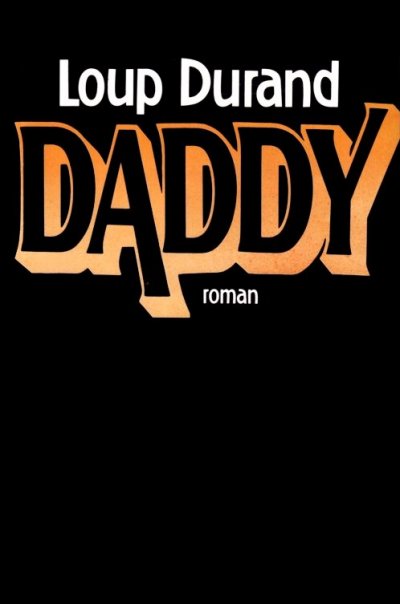
Daddy
de
Loup Durand
Thriller
Maison de la Presse (roman) 1987
Lecture en 9½ h environ, Note : 5.0/5
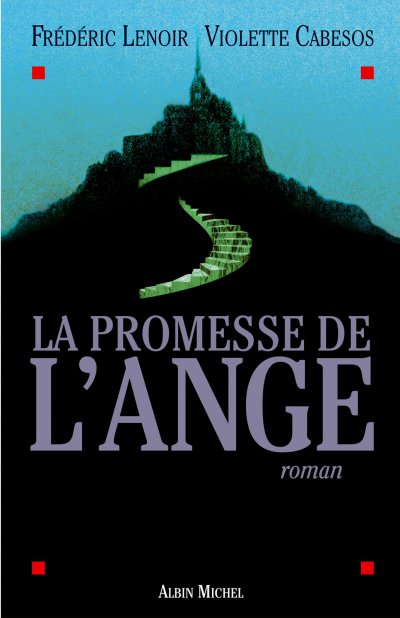
La promesse de l'ange
de
F. Lenoir (et V.Cabesos)
Thriller
Maison de la Presse (roman) 2004
Lecture en 12 h environ, Note : 5.0/5
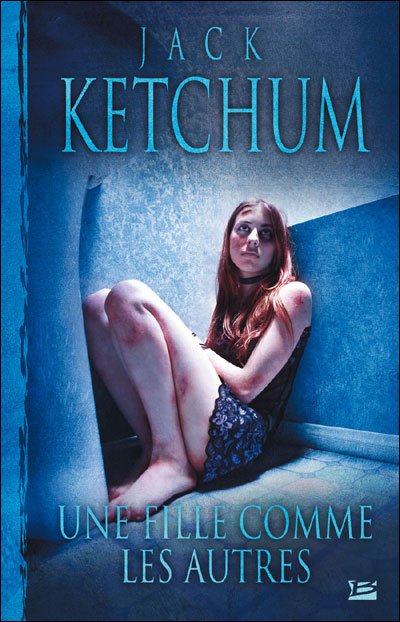
Une fille comme les autres
de
Jack Ketchum
Thriller
Lecture en 5 h environ, Note : 5.0/5
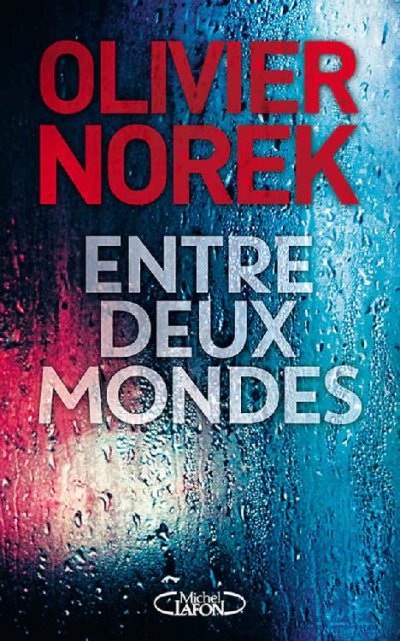
Entre deux mondes
de
Olivier Norek
Thriller
Lecture en 5 h environ, Note : 5.0/5
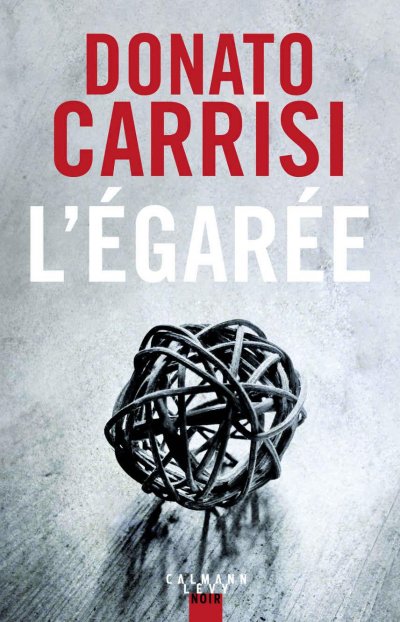
L'égarée
de
Donato Carrisi
Mila Vasquez (3)
Thriller
Lecture en 5 h environ, Note : 4.0/5
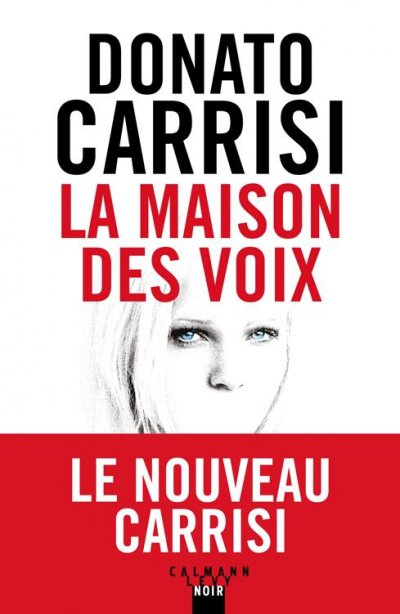
La maison des voix
de
Donato Carrisi
Pietro Gerber (1)
Thriller
Lecture en 5 h environ, Note : 4.0/5
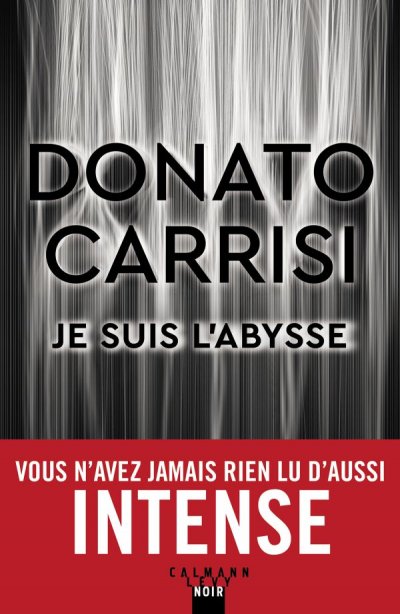
Je suis l'abysse
de
Donato Carrisi
Thriller
Lecture en 5 h environ, Note : 4.0/5
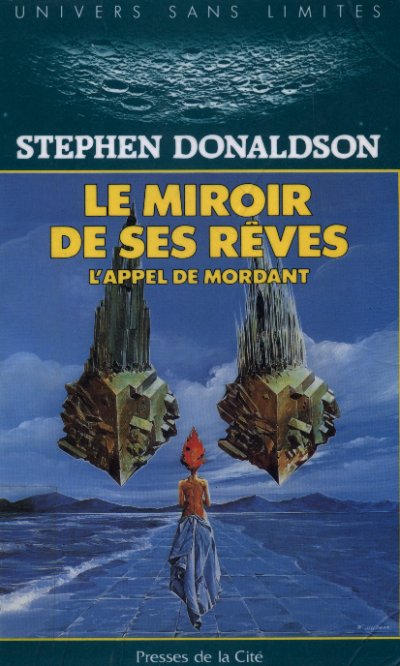
Le miroir de ses rêves
de
Stephen R. Donaldson
L'appel de Mordant (1)
Fantasy
Lecture en 10 h environ, Note : 5.0/5
Les commentaires :
Usterbr
2012-10-16 11:58
Autant le chuchoteur avait été un réel plaisir à lire, autant celui-ci me laisse indifférent. Bien que le même style soit appliqué pour ce bouquin, l’histoire reste en deçà de ce qu’il a pu faire et elle prend trop de temps à se mettre en place.
Dernier livre lu : (aucun)
Livre en cours : (aucun)
Livre en cours : (aucun)
DLCH
2014-03-26 13:05
C’est l’histoire d’un (ou plusieurs) prêtre(s), d’une fliquette, d’un agent d’Interpol et d’un (ou plusieurs) tueur(s) en série (non ça n’est pas une blague), de leurs destins croisés lorsque la jeune femme, technicienne de la police scientifique milanaise, décide de partir enquêter en free-lance sur les circonstances de la mort de son mari, reporter de son état, à Rome. Ce qui va la mener à rechercher la dernière victime d’un serial killer tombé dans le coma, le tout sur fond de sous-ordre de l’Eglise Catholique (pour ne pas dire “secte”) de curés-profilers à l’existence plus ou moins illégale. Là où Carrisi pouvait faire l’erreur (et se péter les dents comme tant d’autres) de tomber dans un roman policier ésotérico-symbolico-ecclésiastique à la Dan Brown (qui sait très bien faire ce qu’il fait mais les deux écrivains ne boxent pas dans la même catégorie), il réussit, au contraire, à conserver à la fois son identité littéraire (car rien n’est jamais irrationnel, tout trouve son explication dans les déviances de la psyché humaine) et son identité d’écrivain européen avec cette authenticité et cette sensibilité caractéristiques tout court. Comparons donc ce qui est comparable : “Il tribunale delle anime” est un roman plus bavard, moins dans l’action pure que le précédent (personne ne se tire dessus pour ne pas perdre connaissance ici), moins glauque aussi (dans une certaine mesure). Le rythme est donc plutôt lent (et là je crains un peu la traduction française, sûrement très fidèle, mais qui doit certainement manquer d’allure, question de musicalité de la langue je pense) et on a l’impression que la fin traine en longueur mais il fallait bien ça pour que l’auteur ne saborde pas son roman, n’écrive pas un dénouement décevant, une issue à la con. Donato Carrisi exploite tous ses sujets jusque dans leurs abysses et fait monter l’angoisse crescendo pour atteindre des sommets de “rhoooooo p*tain !!!!!!!” à la toute fin de son livre. Il pousse donc encore plus loin ses problématiques en introduisant aussi une réflexion sur la responsabilité pénale (...). Je suis bien contente de ne pas être amenée à devoir légiférer sur ce point : est-ce qu’en effaçant la mémoire d’un individu (au sens propre comme au figuré), on efface aussi le poids de son passé, de sa culpabilité (ressentie ou avérée) ? Nos actions, bonnes ou mauvaises, caractérisent-elles fermement et définitivement nos êtres ? Existe-t-il une justice, une forme d’absolution ou de rédemption ? Le Mal, comme le Bien, sont-ils de l’ordre de l’inné ou de l’acquis ? Sommes-nous condamnés à reproduire les mêmes erreurs si la vie (ou la science) nous offre une seconde chance ? Sont-ce véritablement des erreurs (en dehors des meurtres sadiques d’innocents et de petits animaux bien sûr) ? (Et là on tombe plutôt dans un scénario d’anticipation pompé sur Gondry dans “Eternal Sunshine (...)”) Ainsi, une fois les jalons posés (bon, ok, ça prend une bonne grosse moitié de bouquin), Carrisi nous entraîne dans les méandres des personnalités de ses personnages que l’on croyait avoir cernés, dont on pensait pouvoir prévoir les réactions : l’auteur réussit à nous surprendre, encore et encore, enchaînant les cliffhangers magistralement orchestrés (et d’autres moins... Personne n’est parfait, faut pas exagérer !). Car c’est bien cela qui nous intéresse dans la vision du bien et du mal de l’auteur, le fait que les personnages positifs ne le sont jamais totalement et inversement, cette frontière ténue, et définitivement humaine finalement, entre les gentils et les méchants.
Là où d’autres écrivains se seraient arrêtés à la mort du gros méchant tout désigné,